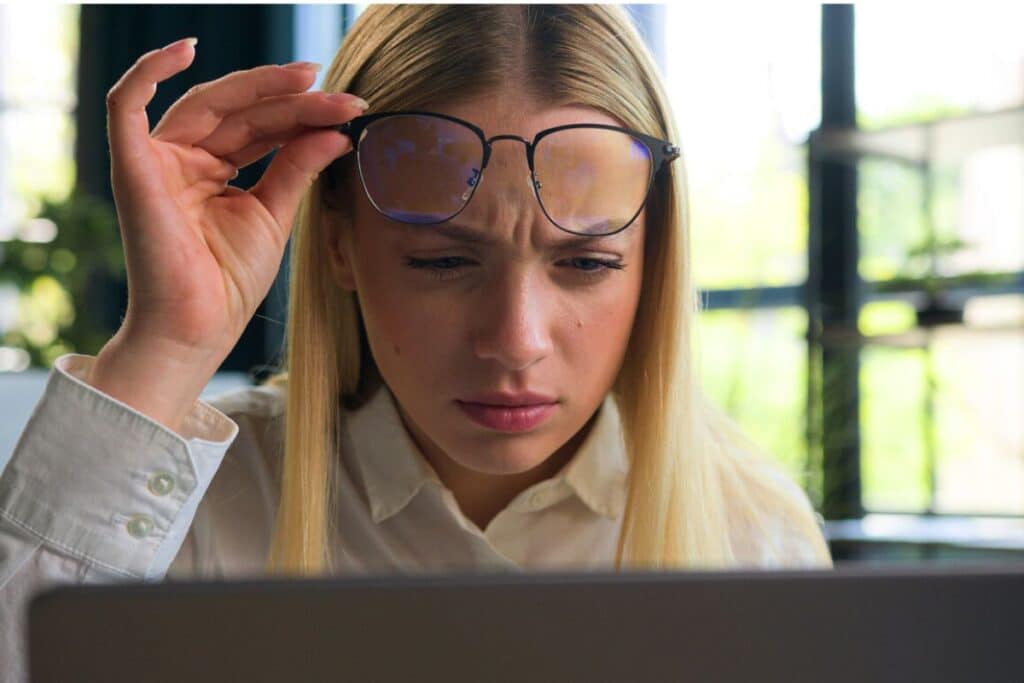Dans les lycées comme à l’université, l’intelligence artificielle générative s’est glissée sans bruit mais avec efficacité dans le quotidien des élèves. Rédaction de devoirs, fiches de révision, aide aux exposés… Deux ans après l’arrivée de ChatGPT, l’outil est devenu aussi commun qu’un stabilo ou une calculatrice. Un compagnon discret, mais parfois controversé.
L’IA, nouvel assistant scolaire
Carla, 18 ans, élève en terminale dans le Var, l’utilise depuis plus d’un an. Résultat ? Une moyenne passée de 12 à 15/20, et un sentiment d’efficacité retrouvé. Elle s’en sert pour structurer ses dissertations de philo, illustrer ses propos en histoire-géo, et clarifier ses devoirs scientifiques. Mais toujours avec une vérification finale de sa part. « C’est un super point de départ, mais je garde l’œil », confie-t-elle.
Elle n’est pas la seule. D’après un rapport sénatorial de juin 2024, 83 % des jeunes de 18 à 21 ans utilisent l’IA dans leurs études, et 75 % d’entre eux y ont recours presque quotidiennement. Pourtant, selon Grégoire Borst, chercheur au CNRS, beaucoup d’élèves ne comprennent pas vraiment comment fonctionne cette technologie, la confondant parfois avec un simple moteur de recherche. Or, l’IA générative repose sur des associations de mots, pas sur des connaissances factuelles solides.
Mathurin, 15 ans, l’utilise dès qu’il révise. Il photographie ses leçons, et l’IA lui propose une fiche synthétique et claire. « Je gagne un temps fou », dit-il. En cas de blocage, une question à ChatGPT, et la réponse arrive en quelques secondes. Pour lui, l’IA, c’est un camarade discret qui « explique sans juger ».

Une tentation d’en abuser
Mais tout le monde ne s’arrête pas à un usage pédagogique. À Sens, Bassem et ses amis ont même partagé un abonnement payant pour accéder à des fonctions premium, qu’ils utilisent… pendant les contrôles. Smartphone caché, copies prises en photo, demandes de sortie aux toilettes pour consulter les réponses : « On est nombreux à faire ça, et cette année, personne ne s’est fait prendre », glisse-t-il.
Le problème, c’est que l’écart entre les notes et le niveau réel risque de se creuser. Même les plus studieux, comme Carla, en sont conscients. « Si on en devient trop dépendant, on s’épargne l’effort. Et le jour où l’on doit tout faire seul, on rame. » Même son de cloche chez Mathurin : « Mes parents me préviennent : à force de tout déléguer, je vais oublier comment réfléchir ».
À la fac, les étudiants sont tout aussi friands. Sarah, en master de droit, utilise ChatGPT pour lister des sources juridiques en un clic. « Un TD qui prenait 20 heures, aujourd’hui j’en fais le tour en 6 ou 7 », sourit-elle. Mais dès qu’il faut creuser un point complexe ou trouver une jurisprudence spécifique, elle avoue que « l’IA atteint vite ses limites ».
Un outil qui divise… et creuse les écarts
Esteban, en licence à Paris-Saclay, s’en sert pour remettre en forme ses notes désordonnées. Des phrases incomplètes, des idées mal tournées ? ChatGPT restructure, clarifie, synthétise. « Je gagne en clarté, mais je retiens moins », admet-il. Cette ambivalence se retrouve chez beaucoup d’étudiants : un gain de temps certain, mais un effort intellectuel réduit.
Et tout le monde n’en est pas fan. Julie, en licence d’histoire-géo à la Sorbonne, a vu la moitié de sa classe utiliser l’IA en prépa littéraire. Elle, a tenu bon. « C’est tricher, même si ce n’est pas illégal », tranche-t-elle. Ce qui la dérange surtout, c’est de voir des camarades obtenir de meilleures notes avec moins d’effort, sans que cela soit sanctionné. « Les profs savaient, mais fermaient les yeux », regrette-t-elle.
Côté enseignants, la détection reste compliquée. Des outils comme Compileo ou Examino existent, mais leur fiabilité est encore incertaine. Faute de preuves solides, les enseignants doivent redoubler de vigilance… ou d’imagination pour adapter leurs évaluations.
Aujourd’hui, l’IA générative fait partie intégrante du paysage scolaire. Si elle aide à apprendre, elle peut aussi encourager la facilité. L’enjeu pour l’école est désormais d’apprendre à ses élèves non seulement à s’en servir… mais aussi à savoir quand il faut l’écarter. Car la vraie réussite, c’est encore celle qu’on construit avec sa propre tête.